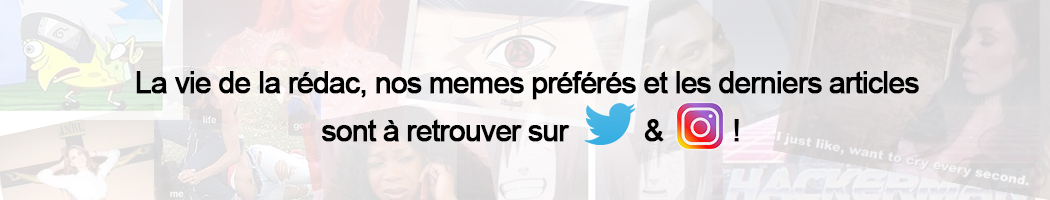Chère dépression,
Je te traîne depuis un moment déjà, on le sait toutes les deux. C’est pas la première fois qu’on trébuche le nez dans la m**. J’ai la sensation de t’avoir toujours un peu sentie, dans mes poches, dans mes chaussettes, comme un petit gravier, celui qui m’écorchait un peu mais que j’avais la flemme d’enlever tant qu’il ne m’empêchait pas de marcher. Mais p** depuis plusieurs mois t’es plus un gravier, t’es un chantier à toi toute seule. Un éboulis à l’intérieur de moi. Un tas de gravats.
Ou alors t’es un p** de rocher. Un caillou énorme. Un menhir presque. Je sais pas trop pourquoi, je fais de la spéléo en toi. Je t’ai regardé par au-dessus avant de plonger complètement. T’es aussi belle dehors que dedans, comme dirait mon plan Q.
Je te traîne à bout de bras. Tu t’accroches à moi. Si je savais encore faire des jeux de mots je ferais encore une référence sex-friend en te disant que t’es comme lui, ma bitte d’amarrage, et ça me ferait marrer. Mais je ne sais plus faire de jeux de mots. Je ne fais plus de jeux du tout. C’est pas que je n’ai plus envie, c’est juste que ça ne me vient pas à l’esprit. Quand ça fait longtemps qu’on n’a pas fait de vélo, ça ne nous vient pas à l’esprit de partir pédaler au bord du canal. On les voit, les cyclistes, on sait que c’est agréable de rouler au soleil, mais on n’y pense pas.
J’ai l’impression de regarder la vie depuis un fauteuil inconfortable au théâtre. C’est un chouette spectacle. Les comédiens ont tous l’air convaincus de leur rôle. Moi je suis seule dans la salle à hurler qu’il n’y a pas de coulisses. Je ne joue pas. Comme je t’ai dit, je ne joue plus. J’ai même arrêté d’écrire. Je n’écris plus.
Bien sûr je pense à la mort. A chaque fois que je passe avec toi sur le pont qui enjambe le périph’ pour arriver chez moi, à chaque fois que je marche avec toi le long du canal, à chaque fois que j’ouvre avec toi le tiroir des couteaux de cuisine. Bien sûr je pense à la mort. J’ai la sensation étrange que mon esprit s’est déplacé. Il s’est tiré, remplacé par tes cailloux. Dans les couloirs de mon corps ça résonne tellement c’est vide. Tout a déserté. La faim, le désir, le plaisir, même fugace, je ne te parle même pas de bonheur, mais juste de ces étincelles dans le corps, ces crépitements incandescents de vie. Tout s’est éteint. Ca sent le cramé à l’intérieur de moi, ça sent les bougies d’anniversaire quand on les a soufflées en oubliant de faire un voeu, ça sent l’allumette gaspillée, c’est du charbon mon cerveau. Et toi, avec ton sourire de granit.
Un jour on m’a comparée à un volcan. Une énergie démesurée qui ne demande qu’à être déclenchée, pour créer, ou détruire. Le souci avec les volcans, c’est qu’ils peuvent aussi s’éteindre. Je suis un volcan éteint. On a étouffé mon feu. Je suis un paysage en désolation après le grand incendie. Je suis une vieille allumette rabougrie. Je suis les cendres qui restent dans la cheminée après les fêtes de famille. Je suis un volcan et toi t’es définitivement de la roche. T’as pas de vie t’as pas de mort. T’es creuse et pleine à la fois. T’es laide et puis t’es lourde. Y a rien qui peut pousser sur toi, rien qui peut s’accrocher. T’es lisse à chialer, on dirait une baignoire. Une baignoire encaillassée qu’a trop brûlé. Je suis noyée avec des pierres dans mes chaussures.
Je te traîne depuis un moment déjà et plus ça va plus j’ai la sensation qu’on s’est immobilisées. On n’avance plus. On ne recule pas non plus. Tes briques roses pèsent tellement lourd sur mon dos que je n’ai plus d’énergie pour le mouvement. T’étais un petit gravier et finalement tu t’es transformée en boulet de démolition. C’est moi que tu laisses en tas de graviers. Je n’attends plus qu’une chaussette me ramasse, je serai son gravier, celui qui l’écorchera un peu mais qu’elle aura la flemme d’enlever tant que je ne l’empêcherais pas de marcher.
Caillassement tienne,
B.